
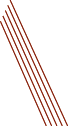
Les débuts (1901-1908)
Gleizes commence à peindre en autodidacte autour de 1901 à la manière des impressionnistes. Ses paysages des environs de Courbevoie s’inspirent notamment de Sisley ou de Pissarro. Mais, après quelques années, la pratique assidue du dessin conduit Gleizes à se détourner progressivement de ce style pictural. Entre-temps, l’artiste a participé à l’aventure de l’éphémère « Abbaye de Projet de couverture pour Créteil », petite colonie de littérateurs regroupés autour d’une imprimerie artisanale. Gleizes fait à l’occasion quelques illustrations pour des ouvrages édités par ses amis. Dans ses dessins autonomes, Gleizes marque à partir de 1907 un intérêt soutenu pour le monde du travail et de l’industrie. Témoin de l’industrialisation rapide de la banlieue parisienne, il représente volontiers l’activité des mariniers des bords de la Seine, dans un esprit à la fois naturaliste et symboliste. Parallèlement, l’usage du lavis d’encre brune étendu au pinceau fait évoluer le style de l’artiste vers un rendu plus synthétique. Les rares tableaux peints par Gleizes en 1908 manifestent un intérêt nouveau pour la couleur et trahissent même l’influence passagère du fauvisme.
Vers le cubisme (1909-1910)
En dehors de quelques portraits, où il prend volontiers pour modèles des écrivains, anciens membres comme lui de l’Abbaye de Créteil, Gleizes continue à montrer sa prédilection pour le paysage. Durant l’été 1909, un séjour au cœur des Pyrénées lui donne l’occasion de se convertir à un style linéaire et dépouillé, proche de celui du peintre Henri Le Fauconnier. Gleizes ramène ainsi de Bagnères-de-Bigorre des lavis dont les épais tracés confèrent aux paysages montagneux de cette région le schématisme de cartons de vitraux. A partir de 1910, Gleizes adopte, toujours à l’exemple de Le Fauconnier, un style plus analytique qui le conduit à décomposer les formes en multiples facettes au coloris atténué.
L’épopée cubiste (1911-1914)
Au salon des Indépendants de 1911, où Gleizes expose un nu masculin et Femme aux phlox, ses œuvres, ainsi que celles de Metzinger, Le Fauconnier, Léger et Delaunay réunies dans la même salle 41, suscitent la violente incompréhension des visiteurs. A l’occasion de ce scandale mémorable, le public parisien découvre le cubisme, dont la formule a pourtant été élaborée par Braque et Picasso depuis quelques années. Dans un premier temps, Gleizes tente de concilier traitement cubiste et tradition. Si Cathédrale suggère le rattachement du cubisme à l’art médiéval, Les Baigneuses fait appel à la tradition classique du nu idéal, transporté dans un paysage où fument désormais des cheminées d’usines.
En s’inspirant des théories du philosophe Henri Bergson, Gleizes cherche à partir de 1912 à appréhender « l’objet, non plus considéré d’un point déterminé, mais définitivement reconstruit suivant un choix successif que [s]on propre mouvement [lui] permet de découvrir. » Cette technique est poussée à un haut degré de complexité dans le monumental Dépiquage des moissons, paysage austère où semblent se mêler symboliquement les actions et les lieux. Cette œuvre ambitieuse, l’un des plus grands tableaux de l’histoire du cubisme, figure en bonne place au Salon de la Section d’Or, important rassemblement de la plupart des artistes progressistes en octobre 1912. Dans le domaine du portrait, L’Editeur Eugène Figuière constitue autant un manifeste de la « simultanéité en peinture » qu’un hommage à l’éditeur de Du « Cubisme », premier ouvrage sur le cubisme, publié par Gleizes et Metzinger en 1912. Avec Les Joueurs de football, Gleizes représente un sport collectif d’importation récente, le rugby (encore appelé football à cette époque), qui inspire au même moment à Robert Delaunay son Equipe de Cardiff . C’est sans doute sous l’influence de ce dernier que Gleizes à la veille de la guerre recourt progressivement à des tonalités plus vives. Cette évolution culmine avec le Paysage près de Montreuil, où commencent à se manifester des tendances abstraites.
Toul (1914-1915)
Au début de la Première guerre mondiale, mobilisé à Toul en Lorraine, Gleizes produit dans des conditions matérielles précaires des gouaches et de petites encres, où il aborde l’abstraction en précurseur. Gleizes fait aussi des portraits, comme celui du médecin-major de la compagnie, le docteur Lambert. Ce tableau, le seul peint par l’artiste à Toul, adapte la composition de L’Editeur Figuière tout en faisant appel à de larges plans de couleurs sourdes mis en mouvement. Durant cette période, Gleizes collabore aussi avec Jean Cocteau, resté à Paris : il participe à la revue patriotique lancée par le poète, Le Mot, qui publie son « Retour de Bois-le-Prêtre », inspiré par la vision accablante d’un groupe de soldats blessés revenant du front. A la demande de Cocteau, Gleizes prépare aussi des maquettes de costumes pour une adaptation réactualisée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Ce spectacle que Cocteau voulait monter au cirque Médrano devait mêler clowns et acteurs du conflit en cours. Les fonds colorés de ces dessins correspondent aux projections lumineuses qui auraient constitué les seuls décors du spectacle, si celui-ci avait vu le jour. Le Songe, dont Erik Satie devait composer en partie la musique, préfigure Parade, le fameux ballet pour lequel Cocteau s’associera à Picasso, Satie et Massine en 1917.
New-York et Barcelone (1915-1918)
Durant sa période américaine, Gleizes aborde de nouveaux sujets. Saisi par le gigantisme de la métropole américaine, il se met à représenter les gratte-ciel, le pont suspendu de Brooklyn ou encore les publicités lumineuses de Broadway. Les effets de superpositions dynamiques que Gleizes s’autorise semblent faire écho aux rythmes syncopés du jazz, auquel l’artiste a été initié dès son arrivée à New York. Certaines œuvres conçues à Toul, comme le portrait du compositeur Florent Schmitt ou celui de Juliette Roche, trouvent leur réalisation picturale dans l’atelier new-yorkais de l’artiste. A Barcelone, où il passe quelques mois en 1916, Gleizes aborde tout naturellement des thèmes espagnols, comme celui des danseuses, mais aussi celui du cirque, sous l’influence probable de Jean Cocteau, dont il fait alors un étonnant portrait. Le retour vers New York permet à l’artiste de faire escale aux Bermudes, où il peint quelques paysages.
L’Entre-deux-guerres (1918-1939)
Après la Première guerre mondiale, le style d’Albert Gleizes évolue de façon très sensible. Usant désormais d’aplats de couleurs plus ou moins géométriques, l’artiste alterne compositions purement abstraites et figurations allusives. Ressentant la nécessité de soumettre sa pratique artistique à des lois, Gleizes isole bientôt « deux caractères à son activité plastique qui permettent au plan du tableau de se morceler sans se dénaturer organiquement », ce sont les « translations » et les « rotations » de plans colorés qui déterminent l’avènement du « tableau-objet ». Au milieu des années 20, Gleizes s’attache à rendre plus complexe l’organisation du tableau en délimitant sur une même toile, souvent de grand format, plusieurs compartiments, qu’il tentera de relier entre eux par de larges cercles gris au début des années 30. Aisément adaptables à une échelle monumentale, ces compositions conduisent Gleizes à envisager la réalisation de décors liés à l’architecture. Après l’échec d’un projet pour l’Ecole de Pharmacie à Paris, le marchand Léonce Rosenberg lui confie en 1930 la décoration d’une chambre de son appartement parisien. Après avoir renoué le dialogue artistique avec Robert Delaunay, Gleizes participe au Salon des Tuileries de 1938 en concevant deux décors monumentaux sur le thème de la « figure dans l’arc-en-ciel ». Ce thème fait l’objet de plusieurs variations importantes dans son œuvre.
Les dernières années (1940-1953)
Durant la Seconde guerre mondiale, Albert Gleizes, très marqué par le conflit, aborde des sujets plus austères, dont la majesté est renforcée par le choix de formats monumentaux. Gleizes tente de renouveler l’art sacré en s’inspirant des peintures byzantines ou médiévales auxquelles il s’intéresse de près. Pour ce faire, il use d’un vocabulaire plastique associant éléments graphiques évocateurs et plages colorées abstraites. La distribution simplifiée des couleurs, qui viennent contredire la relative sévérité des sujets, évoque la technique, familière à l’artiste, du pochoir. Parallèlement, le cycle des Supports de contemplation semble favoriser l’expression d’une ferveur mystique sans le soutien d’une iconographie religieuse explicite. Scandées par des éléments mobiles qui trouvent leurs origines dans les « rotations », ces compositions invitent à une véritable dynamique du regard. Dans une ultime période, Gleizes explore le thème des Arabesques, où se fait jour une inspiration plus libre dont témoignent notamment ses illustrations pour les Pensées de Pascal, son testament artistique.
→ Biographie d’Albert Gleizes
→ Bibliographie d’Albert Gleizes
[texte par Christian Briend pour la Fondation Albert Gleizes, 2012]
↖ Albert Gleizes, Les Bords de la Marne, 1909, Huile sur toile, 54 x 65 cm – Lyon, musée des Beaux-Arts © Alain Basset
↖ Albert Gleizes, Paysage près de Montreuil, 1914, Huile sur toile, 73 x 92,5 cm – Sarrebrück, Saarland-Museum
↖ Albert Gleizes, Terre et Ciel, vers 1935, Huile sur toile, 136 x 136 cm – Lyon, musée des Beaux-Arts © Alain Basset